L’informatique est aujourd’hui omniprésente dans nos vies. Des smartphones aux objets connectés, en passant par les algorithmes de recommandation ou encore l’intelligence artificielle, cette discipline structure de plus en plus notre quotidien et nos sociétés. En Suisse, pays reconnu pour son excellence en matière d’éducation et d’innovation, l’enseignement de l’informatique a connu une évolution remarquable, du développement des premiers ordinateurs aux programmes actuels axés sur l’IA et l’apprentissage machine. Cet article retrace cette progression à travers quatre grandes étapes : les débuts historiques, l’évolution de l’enseignement dans les écoles et universités, les nouvelles tendances, ainsi que les défis et perspectives actuels.
Notre objectif principal devrait être d’apprendre aux gens à réfléchir, pas seulement à utiliser des outils.
Niklaus Wirth, pionnier de l'informatique suisse

Les débuts de l’informatique en Suisse : l’ERMETH et l’ETH Zurich
L’histoire de l’informatique en Suisse débute dans l’après-guerre, à une époque où le concept même d’ordinateur est encore en pleine gestation. En 1948, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), l’une des institutions les plus prestigieuses du pays, lance le projet de construction du tout premier ordinateur suisse : l’ERMETH (Elektronische Rechenmaschine der ETH).
L’ERMETH est achevé en 1956 sous la direction du mathématicien Eduard Stiefel et avec la collaboration de Heinz Rutishauser, un pionnier dans le développement des langages de programmation. Cet ordinateur analogique est l’un des premiers à être capable de traiter des instructions complexes et à être utilisé pour des calculs scientifiques.

L’ETH Zurich joue alors un rôle fondamental dans la formation des premiers informaticiens suisses. Ce n’est pas encore une discipline autonome, mais l’informatique est intégrée aux cursus de mathématiques, d’ingénierie et de physique. À cette époque, l’informatique reste confinée aux centres de recherche et aux universités, son accès étant limité à quelques spécialistes. Souhaitez-vous découvrir les plus grands pionniers suisses en informatique ?
📍 1948
Lancement du projet ERMETH
L’ETH Zurich initie le développement du premier ordinateur suisse, l’ERMETH (Elektronische Rechenmaschine der ETH), sous la direction d’Eduard Stiefel.
📍 1950–1955
Travaux de recherche et conception
Collaboration entre Eduard Stiefel, Heinz Rutishauser et Ambros Speiser. Début de l’implémentation des idées autour des langages de programmation et du calcul scientifique automatisé.
📍 1956
Achèvement de l’ERMETH
L’ERMETH est opérationnel. Il s’agit d’un ordinateur analogique capable de réaliser des calculs scientifiques complexes. Il fonctionne avec des cartes perforées et sans écran.
📍 Années 1950–1960
Formation des premiers informaticiens suisses
L’ETH Zurich intègre l’informatique dans les filières de mathématiques, d’ingénierie et de physique. L’ordinateur reste un outil réservé à la recherche académique et scientifique.
📍 Années 1960
Premiers développements en langages de programmation
Heinz Rutishauser participe à la création du langage ALGOL, qui influencera profondément les langages modernes comme Pascal, C et Java.
L’évolution de l’enseignement de l’informatique dans les écoles et universités
Au fil des décennies, l’informatique est passée d’un domaine réservé à une élite universitaire à une compétence fondamentale pour l’ensemble de la population. Le système éducatif suisse, réputé pour sa rigueur et sa capacité d’adaptation, a progressivement intégré cette discipline dans ses programmes, à tous les niveaux de formation. Retour sur cette évolution marquante.
Les années 70–90 : l’informatique devient une discipline universitaire
Il faut attendre les années 1970 pour que l’informatique se constitue en tant que champ d’étude indépendant. L’ETH Zurich crée un département spécifique d’informatique en 1981, suivi par d’autres institutions, telles que l’Université de Genève, l’Université de Lausanne et l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne). Ces institutions développent des cursus complets allant du bachelor au doctorat, avec des spécialisations en algorithmique, bases de données, réseaux, intelligence artificielle, etc.

Dans les années 80, la démocratisation des micro-ordinateurs (comme l’Apple II ou le Commodore 64) commence à introduire l’informatique dans les écoles secondaires. Cependant, cette introduction reste modeste et inégale selon les cantons, le système éducatif suisse étant fortement décentralisé.
Les années 2000–2010 : l’informatique entre dans le secondaire
Au début des années 2000, la nécessité d’introduire l’informatique de manière plus structurée dans les écoles devient évidente. L’arrivée massive d’Internet, la généralisation des outils numériques et la demande croissante en compétences informatiques sur le marché du travail poussent les autorités éducatives à revoir les programmes. Quel est le rôle de la Suisse dans l'informatique moderne ?

Les élèves apprennent à utiliser des logiciels de bureautique, mais aussi les bases de la programmation, de la sécurité numérique et de la logique algorithmique. En 2014, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) propose une harmonisation des programmes via le Plan d’études romand (PER) et Lehrplan 21 (Suisse alémanique), qui incluent des modules dédiés aux compétences numériques dès l’école primaire.
L’enseignement supérieur et la formation continue
Les hautes écoles spécialisées (HES) et universités offrent aujourd’hui des cursus diversifiés en informatique, adaptés aux besoins de différents profils : développement logiciel, cybersécurité, sciences des données, systèmes embarqués, etc. Les EPF (ETH Zurich et EPFL) restent à la pointe de la recherche et de l’innovation, attirant des étudiants du monde entier.
La formation continue prend également de l’ampleur, avec des certificats, diplômes et masters exécutifs pour les professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner. La Confédération soutient ces formations à travers des programmes comme le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ou Innosuisse.
📍 Années 1970
L’informatique devient une discipline universitaire autonome
Débuts de la structuration de l’informatique comme champ d’étude à part entière.
📍 1981
Création du département d’informatique à l’ETH Zurich.
Lancement des premiers cursus complets (bachelor à doctorat) en informatique.
📍 Années 1980
Arrivée des micro-ordinateurs dans certaines écoles secondaires
Introduction encore limitée et inégale selon les cantons.
📍 Années 2000–2010 .
L’informatique devient transversale dans l’enseignement secondaire
Réforme des programmes pour intégrer bureautique, programmation et cybersécurité
📍 2014
Mise en place du Plan d’études romand (PER) et du Lehrplan 21
Harmonisation nationale des compétences numériques dès l’école primaire.
📍 Aujourd’hui
Les HES, EPF et universités proposent des formations en cybersécurité, IA, data science…
La formation continue se développe (certificats, diplômes, reconversion pro). Soutien actif de l'État via le FNS et Innosuisse.
Nouvelles tendances : IA, bootcamps et apprentissage hybride
L’enseignement de l’informatique ne cesse de se transformer pour suivre le rythme des avancées technologiques. Ces dernières années, de nouvelles méthodes d’apprentissage et de nouvelles thématiques, comme l’intelligence artificielle ou l’apprentissage automatique, ont redéfini les contours de la formation. Ces tendances ouvrent la voie à une éducation plus flexible, rapide et accessible. Souhaitez-vous découvrir des inventions informatiques suisses plus marginalisées ?
L’essor de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique
L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui au cœur de l’évolution de l’enseignement informatique. Les universités suisses ont été parmi les premières en Europe à proposer des cursus dédiés à l’IA et à l’apprentissage machine. L’EPFL, par exemple, a créé un master spécialisé en intelligence artificielle, tandis que l’Université de Zurich héberge le Zurich Machine Learning and AI Lab (ZMLAL), un centre de recherche de pointe.
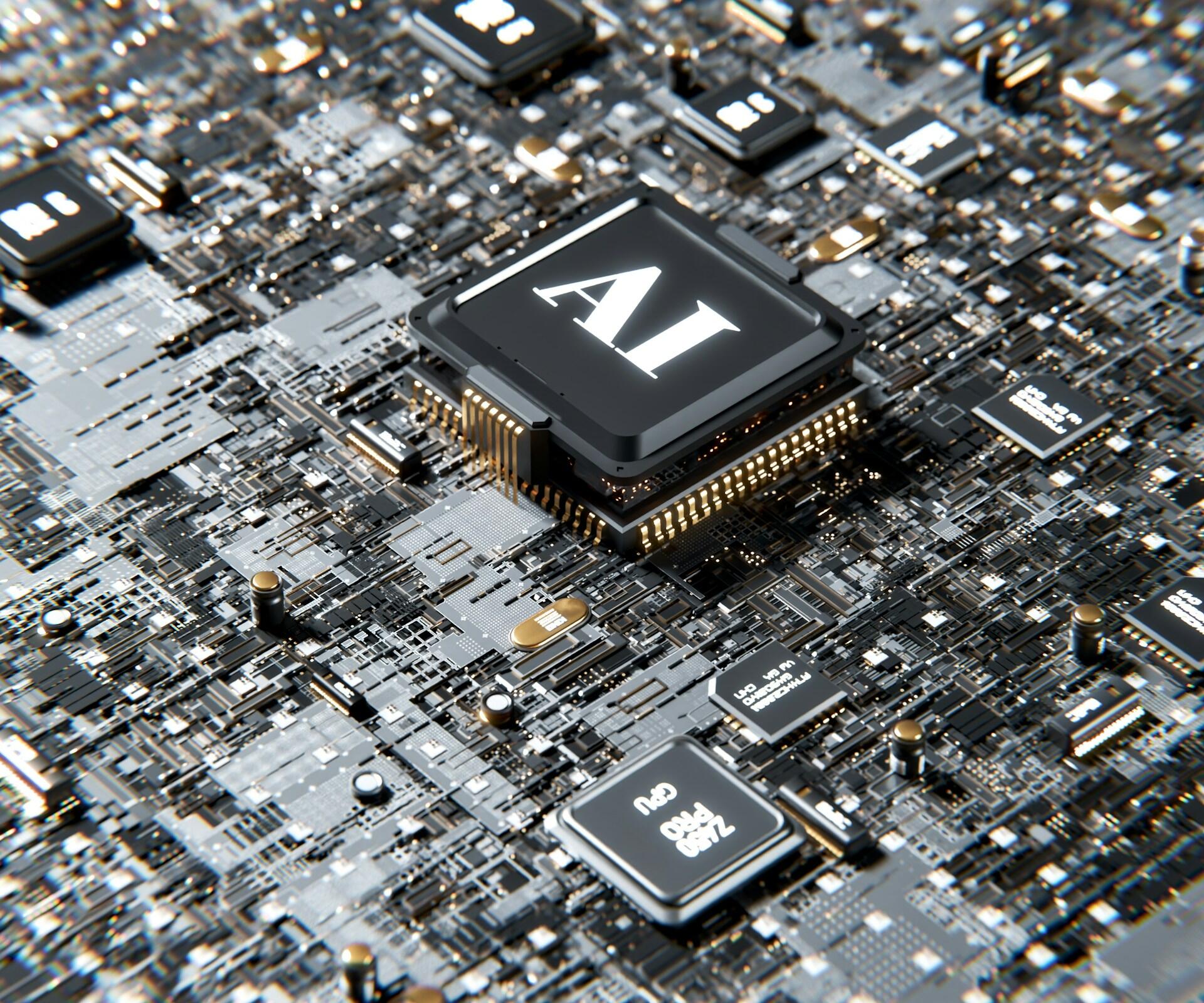
Cette spécialisation répond à une forte demande du marché : les entreprises suisses, de la finance à la biotechnologie, recherchent des profils capables de concevoir des algorithmes, d’analyser des données massives ou encore de développer des modèles prédictifs.
Bootcamps et formations alternatives
Face à l’accélération du numérique, de nouvelles formes d’apprentissage ont vu le jour. Les bootcamps – formations intensives en quelques semaines ou mois – se multiplient dans les grandes villes suisses. Des structures comme Propulsion Academy à Zurich ou Le Wagon à Lausanne forment des développeurs, data scientists et UX designers en un temps record. Voici un exemple par Le Wagon, d'un cours bootcamp de coding.
Ces formations courtes répondent aux besoins de reconversion rapide et d’agilité dans le monde professionnel. Leur approche très pratique attire aussi bien des jeunes sans diplôme que des diplômés en reconversion ou des autodidactes.
Plateformes en ligne et apprentissage individualisé
L’enseignement informatique s’est également digitalisé. De plus en plus de plateformes comme Coursera, edX ou Superprof permettent de suivre des cours en ligne, souvent accompagnés de certifications. Superprof, par exemple, propose un accès direct à des professeurs particuliers spécialisés, permettant un apprentissage individualisé, souple et personnalisé. Ces modèles hybrides, mêlant enseignement formel et autoformation, gagnent en popularité, notamment chez les étudiants et les professionnels qui souhaitent apprendre à leur rythme, en complément de leur parcours académique ou professionnel.
Défis et perspectives de la formation informatique en Suisse
Malgré les progrès remarquables réalisés, l’enseignement de l’informatique en Suisse fait face à plusieurs défis majeurs. L’accès équitable à la formation, l’adaptation constante aux technologies émergentes et l’intégration d’une dimension éthique sont autant d’enjeux cruciaux pour les années à venir. Une réflexion profonde s’impose pour construire un avenir numérique inclusif et durable. Quelles sont les meilleurs inventions suisses en informatique ?
L’égalité d’accès à l’enseignement informatique
En Suisse, on compte environ 17 000 étudiants en informatique. Parmi eux, environ 14 000 sont des hommes et 3 000 des femmes, soit une représentation féminine encore faible dans le domaine.
L’un des principaux défis actuels reste l’égalité d’accès à la formation informatique. Si les grandes villes suisses bénéficient d’une offre éducative dense et diversifiée, certains cantons ruraux ou périphériques restent moins bien desservis. De plus, le fossé numérique persiste entre certaines populations : les femmes, les personnes issues de l’immigration ou les personnes âgées sont encore sous-représentées dans les filières informatiques.
Ces chiffres sont une estimation basée sur les proportions moyennes (≈15–20 % de femmes) dans les universités suisses majeures comme l’ETH, l’EPFL, l’UNIGE, etc.
Des initiatives tentent de corriger ces déséquilibres, comme les programmes Girls in Tech Switzerland, ou les camps de codage destinés aux jeunes filles. Le développement de l’enseignement à distance et de l’e-learning peut également aider à surmonter certaines barrières géographiques ou socio-économiques.
L’adaptation permanente aux évolutions technologiques
Le rythme rapide de l’innovation technologique impose une actualisation constante des contenus pédagogiques. Les enseignants doivent être formés en continu, et les cursus doivent intégrer les dernières avancées : blockchain, cybersécurité, IA générative, etc. Les partenariats entre les universités, les entreprises technologiques et les institutions publiques sont essentiels pour garantir une adéquation entre la formation et le marché du travail. Des programmes comme ceux d’Innosuisse favorisent cette synergie entre enseignement, recherche et innovation.

Vers un numérique éthique et durable
Enfin, une autre dimension importante de la formation informatique en Suisse est l’intégration des enjeux éthiques, sociaux et environnementaux. La maîtrise technique ne suffit plus : il faut aussi former des professionnels capables de réfléchir aux impacts de leurs créations, qu’il s’agisse de la protection des données, des biais algorithmiques ou de l’empreinte écologique du numérique.
Les universités suisses intègrent de plus en plus ces thématiques dans leurs cursus, avec des modules consacrés à l’éthique de l’IA, à la législation numérique ou encore à la sobriété informatique. L’enseignement de l’informatique en Suisse a parcouru un chemin impressionnant, depuis les expériences pionnières de l’ETH Zurich jusqu’aux programmes de formation avancés en IA, en passant par l’intégration dans les écoles et les nouvelles méthodes d’apprentissage.
Le pays s’est imposé comme un acteur majeur de l’éducation numérique, capable d’anticiper les mutations technologiques tout en préservant l’excellence académique. Pour les étudiants de tous âges, les possibilités n’ont jamais été aussi nombreuses : études universitaires, reconversions professionnelles via les bootcamps, ou accompagnement personnalisé via des plateformes comme Superprof. L’enjeu, désormais, est de garantir un accès équitable à ces opportunités, tout en formant une génération de citoyens et de professionnels numériques responsables, critiques et engagés. Alors, c'est parti ?
Résumer via IA :















