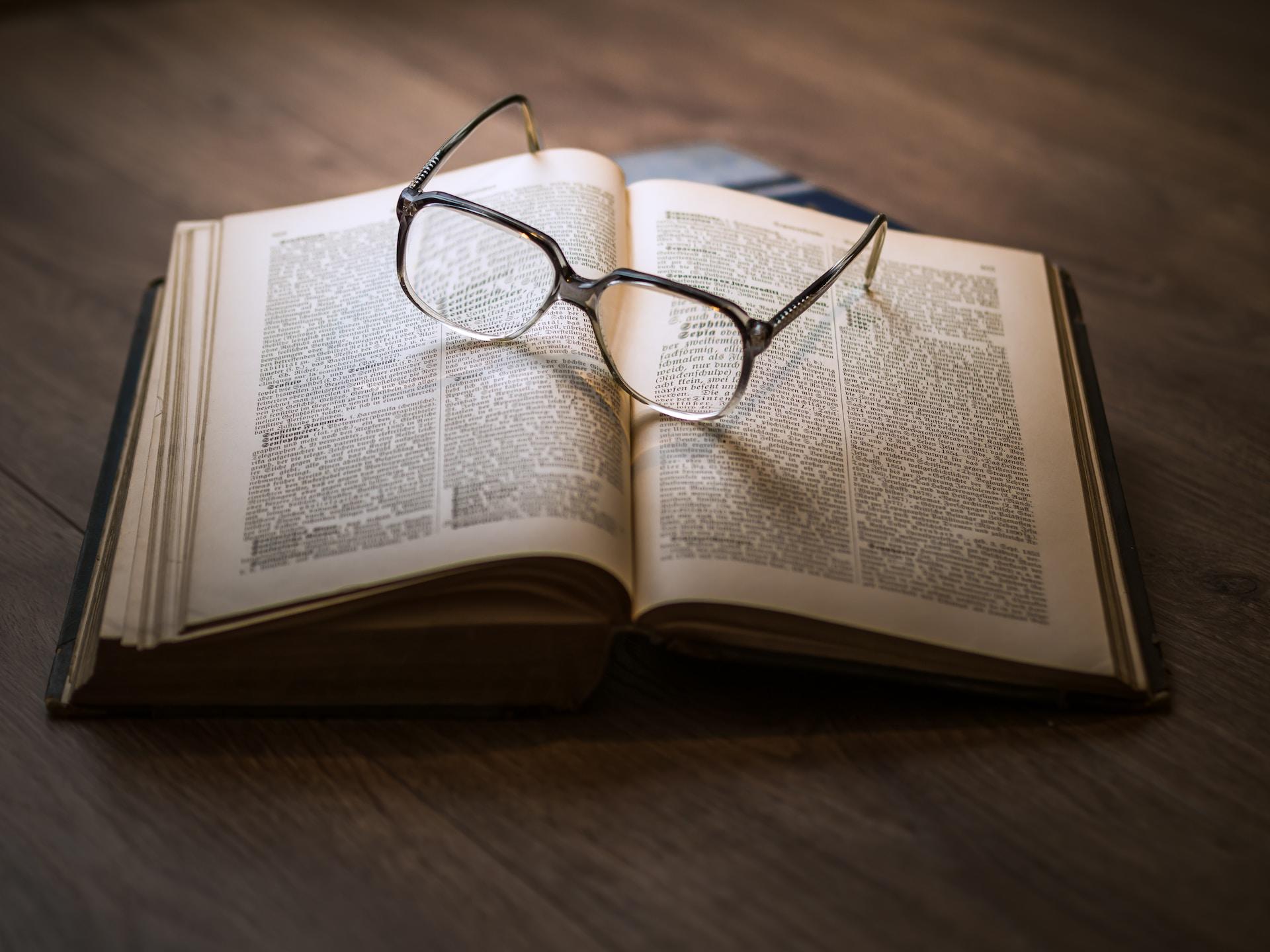Si le français nous apparaît être une langue très riche, beaucoup plus que de nombreux autres langues, c'est principalement en raison de son ancienneté. En effet, le français n'est pas une langue dénuée d'histoire, bien au contraire ! Le français, d'ailleurs, porte ce nom depuis de nombreux siècles, avec des variations. Il est certain en tout cas qu'il n'est pas aussi simple d'expliquer et de retracer l'histoire de cette langue, comme il serait plus facile de le faire pour une langue comme le luxembourgeois, par exemple ! La langue française possède une très riche histoire, avec tant de rebondissements, tant d'argots, ces derniers ayant forgé la langue que nous connaissons aujourd'hui…

Le français aujourd'hui
Aujourd'hui, au XXIe siècle, le français est l'une des six langues de l'ONU, mais elle est également la langue de la diplomatie, des relations internationales, du Comité international olympique, de l'UNESCO (parmi d'autres langues)… Le français est systématiquement l'une des langues officielles de chaque organisation internationale ! C'est dire. Il faut souligner aussi le fait que le français est la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur tous les continents de la Terre ! Lorsque l'on souhaite obtenir un emploi dans l'international, on est forcé de parler le français.
Chaque année, sur chacun des continents est fêté la semaine de la francophonie. Il s'agit d'une semaine située au mois de mars ! Cet événement existe depuis sa création en 1988, aussi bien en France qu'en Suisse ou encore en Belgique. De nos jours, le français est une langue internationale parlée par 300 millions de personnes en tant que langue officielle, maternelle ou secondaire. À ce titre, le français occupe ainsi la 5e place des langues les plus parlées du monde, derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol ainsi que l'arabe. 32 pays disposent du français en tant que langue officielle, ce qui prouve encore une fois sa dimension internationale !

Et cependant, le français a mis énormément de temps, de siècles, à se construire et à devenir la langue que l'on connaît aujourd'hui et que l'on appelle couramment le "français". Les anagrammes n'ont pas toujours été appelées ainsi, loin de là ! Un peu d'histoire à présent.
Le francien, d'où vient-il ?
Le francien est en réalité le nom donné au XIXe siècle au langage qui s'apparente le plus à notre français actuel et qui aurait ainsi donné le français moyen. Il s'agit de l'un des langages du vieux français. Car oui, le vieux français n'est en fait pas une langue, mais bien plusieurs langues ! Voilà pourquoi il est faux de dire que le vieux français était une langue... Le vieux français rassemblait en tout les cas les langues dites "d'oïl", dialectes parlés dans le Nord de la France donc. En fait, le vieux français se composait de plusieurs dialectes langues d'oïl, on peut dire : le gallo, le lorrain, le normand, le picard, le wallon…
D'où vient le francien réellement ? Il s'agit du langage le plus proche de notre français actuel, et duquel découlent les futurs langages de français (moyen français, français classique, français moderne). En 800 après J.-C., lorsque Charlemagne instaure à nouveau le latin au sein des écoles (dont seuls les enfants de familles aisées bénéficient) et des Eglises, le peuple demeure le seul à parler encore les dialectes communs de l'époque. Ils parlaient donc le romand. Malgré cela, le romand parlé au Sud et au Nord du pays ne se ressemble pas. On instaure alors de suivre un langage en particulier afin de bien se comprendre entre Français : le francien.
Pour retracer son histoire, il faut dire que le francien fait partie des langues d'oïl, parlées dans le Nord de la France (donc l'Île-de-France faisait partie dans le parler de l'époque) et dans la Wallonie actuellement (qui n'existait donc pas à l'époque). Nous sommes maintenant au Moyen-Âge, aux XIIe et XIIIe siècles. Pourquoi appelle-t-on encore aujourd'hui "langues d'oïl" et "langues d'oc" certains groupes de langues ? Voilà le genre de question qui anime parfaitement un cours de français lausanne ! Parce qu'à l'époque, les langues d'oïl disaient "oïl" pour dire notre "oui" actuel, tandis que les langues du sud du pays disaient, par endroits, "oc".

Ces langues d'oïl proviennent elles-mêmes des langues dites gallo-romanes, provenant quant à elles du latin vulgaire ! Il faut savoir que les historiens reconnaissent que le francien, autrement appelé à l'époque le français donc, est le langage le plus proche du français actuel, car le français standard élaboré provient du francien.

Le francien : langue parlée à Paris
Il faut savoir qu'on appelle "francien" un langage qui s'appelait "françois", et qui est devenu au fil des siècles le "français". Le francien, ou françois, était essentiellement parlé dans la capitale, Paris, et aux alentours. En fait, le francien, ou françois, est bien le premier langage rattaché à notre français actuel, ayant son origine à Paris même. Avant cela, le "vieux français" comme on l'appelle provenait de bien d'autres dialectes dans le reste de la France !
Comment en est-on arrivé à parler le francien, ou le françois ? En réalité, le francien provient notamment d'un développement à partir du langage roman germanique de l'élite des Francs. L'art change toute langue, mais il n'est pas le seul ! À partir du XIIIe siècle surtout, les classes d'élite commencèrent à parler le francien, ce dernier prenant donc peu à peu la place du francique. C'est avec le roi Louis IX, Saint-Louis, que le francien que le francien devint symbole de prestige en France. Il fut définitivement adopté par les "couches supérieures" de la société française de l'époque à ce moment-ci, et ce, également aux alentours de la capitale. Le peuple continuait de parler les différents dialectes communs, mais en tout cas, l'élite parlait très bien le francien.
Les différences entre le francien (l'une des langues du vieux français) et le moyen français
Le français moyen apparut quant à lui en 1340, selon les historiens, et fut remplacé par le français classique en 1611. Les différences notables que l'on peut mentionner et dont on vous parlera nécessairement en cours de français genève concernent une plus grande rigidité de l'ordre des mots dans une phrase. En effet, il faut dire que pour un francophone parlant le français couramment, tel qu'on l'enseigne aujourd'hui, mais ne connaissant absolument pas l'ancien français, le francien est pratiquement impossible à comprendre dans sa totalité. Parfois même, le sens de la phrase n'est pas déductible, tant les mots s'enchaînent dans des ordres que nous ne connaissons pas du tout.

Nous pouvons avoir l'impression, à raison, qu'aucun ordre n'était établi au sein des phrases du francien. À titre d'exemple, citons une phrase du roman de Chrétien de Troyes, Erec et Enide : "Son seignor dire ne l'ose". Que comprenez-vous réellement ici ? Si vous n'êtes pas certain(e) de bien comprendre, vous pouvez bien entendu faire appel aux services d'un prof qui vous expliquera tout dans les moindres détails durant un cours intensif de français ? On pourrait logiquement, avec notre connaissance de la langue et de ses règles de syntaxe et grammaire actuelles, se dire que cela signifie : "Son Seigneur n'ose le dire". Et pourtant… ce n'est pas du tout le cas ! Au contraire, on doit ici comprendre : "Elle n'ose pas le dire à son seigneur". Ainsi, on voit bien que le sujet de la phrase, à savoir "Son seignor", n'est pas le sujet puisque le verbe "ose" ne s'y rapporte pas… Compliqué, n'est-ce pas ?
Que pensez-vous également de l'ordre des mots dans cette phrase de francien : "Que nul semblant ne rien en face" ? Le moyen français, lui, veut fixer plus de règles d'ordre des mots afin que tout n'aille pas dans tous les sens. La seconde différence notable que l'on peut souligner est l'intégration récente de mots appartenant à l'italien : plus de 8 000 mots en tout à cette période !
Quelques exemples de textes écrits en francien
Bien avant que l'on ne s'intéresse à la langue des signes française, citons les auteurs les plus connus des XIIe et XIIIe siècles en France : Rutebeuf, Chrétien de Troyes, Béroul, Guillaume de Lorris…
Rutebeuf, Œuvres complètes, "C'est de la Povretei Rutebeuf"
Ms. 7633.
Je ne sai par où je coumance,
Tant ai de matyère abondance
Por parleir de ma povretei.
Por Dieu vos pri, frans Rois de France,
Que me doneiz queilque chevance :
Si fereiz trop grant charitei.
J’ai vescu de l’autrui chatei
Que hon m’a créu et prestei ;
Or me faut chacuns de créance,
C’om me seit povre et endetei :
Vos r’aveiz hors dou reigne estei

Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal
Qui petit seme petit quialt,
et qui auques recoillir vialt
an tel leu sa semance espande
que fruit a cent dobles li rande ;
5 car an terre qui rien ne vaut,
bone semance i seche et faut.Crestiens seme et fet semance
d’un romans que il ancomance,
et si le seme an si bon leu
10 qu’il ne puet estre sanz grant preu,
qu’il le fet por le plus prodome
qui soit an l’empire de Rome.
Béroul, Tristan et Yseut
Que nul senblant de rien en face.
Com ele aprisme son ami,
Oiez com el l’a devanci :
5 « Sire Tristran, por Deu le roi,
Si grant pechié avez de moi,
Qui me mandez a itel ore ! »
Or fait senblant con s’ele plore.
Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose
L'autre ymaige apres Félonnie / Estoit nommée Villenie / Seant pres de Haine sur destre / Et estoit presque de tel estre / Que les deux et de tel facture / Bien sembla faulce créature / Mesdisante et trop courageuse / Ainsi que une femme oultrageuse / Brief bien scavoit paindre et pourtraire / Cil qui tel ymage sceut faire / Car bien sembloit chose vilaine / De despit et d'ordure plaine / Et femme qui bien peut scavoit / Honnorer ce qu'elle devoit.
Les différentes formes qu'a pris le français au fil des siècles vous intrigue ? Des cours de français intensif pourront être axés spécifiquement sur ces questions, si vous le souhaitez, pour en apprendre toujours plus !
Résumer via IA :